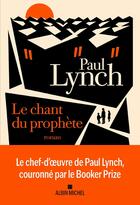Dans La Meilleure Façon de marcher est celle du flamant rose (Flammarion) Diane Ducret se livre comme jamais dans les pas de son héroïne, pour une formidable leçon de vie.
Nous l'avons rencontrée pour lui poser quelques questions.
- La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. Un titre énigmatique… Comment peut-on marcher sur une seule jambe ?
Eh bien on marche mal, justement. Le titre m’est venu avant le livre. On s’est tellement moqué de moi quand je clopinais sur une jambe, avec mes deux béquilles… J’ai eu un grave accident d’équitation quand j’étais adolescente. J’ai passé des années à avoir l’impression de regarder la vie des autres, de voir les plus belles années de ma jeunesse passées dans les préoccupations de la vieillesse, entre rééducations, arthrite, arthrose, et conversations de paralytiques. Même une fois physiquement réparée, j’avais la sensation d’une boiterie intérieure, affective, sentimentale. L’impression d’être montée à l’envers, comme les jambes du flamant rose, trop fragile pour vivre dans le monde actuel. Mais aussi frêle que soit ce flamant, dégingandé, cacochyme, rose en plus, la couleur la moins camouflable dans un habitat naturel, il est capable d’aller vers les Caraïbes pour retrouver l’indéfectible été dont parlait Camus.
- Quelle est la part de fiction ou des confessions dans ce roman ?
L’histoire est à 99 % vrai même si c’est un vrai roman, dans le sens où beaucoup de lecteurs peuvent se retrouver dans le parcours de cette femme qui a grandi sans amour, qui s’est battu contre la maladie, la boulimie, la dépression et les violences, pour réussir à faire sa place dans ce monde.
- Est-ce le récit d’une résilience ?
Je ne sais pas vraiment le dire comme ça. On a fait de la résilience quelque chose de tellement normatif. Pendant des années, après avoir lu toute une littérature sur le sujet, je me disais que j’étais résiliente, mais je ne comprenais pas pourquoi je n’y parvenais pas vraiment, alors que même les rescapés des camps de concentration pouvaient y arriver. La résilience devient un objectif à atteindre, un instrument de culpabilisation : il faut s’aimer soi, pardonner, être reconnaissant ou que sais-je. Non on n’est pas obligé de s’aimer tout le temps ou d’aimer tout de soi. Il y a encore des jours où je ne m’aime pas, où j’ai envie de pleurer. Mais je réintègre tout cela dans un parcours d’humain où l’on met de l’amour sur ces maux-là. Parfois des filles font des dépressions après une rupture, et on les houspille en leur disant de se reprendre, qu’elles n’ont pas le cancer tout de même. Mais laissons les vivre à leur rythme, ça prend le temps que ça prend, on ne relativise pas ce qu’on vit en fonction d’un dogme.
Le discours ambiant nous dit que finalement, si on va mal c’est notre faute, avec tous ces moyens mis à notre disposition pour en sortir. Je me suis fait trouer la peau avec des piercings, des tatouages, j’ai touché mes limites, pris des risques. J’allais mal et j’avais besoin que ça se voie. Et j’ai accepté le syndrome post-traumatique qui a duré dix ans. Finalement, j’ai été capable d’en rire de bon cœur en l’écrivant.
- Il est vrai que votre héroïne, malgré les souffrances qu’elle traverse, n’est jamais plaintive. Vous ne la décrivez jamais comme victime…
C’est exact. Parce que de façon générale, la femme n’est pas une victime d’être femme. J’ai refusé d’être une victime, de me considérer dans le handicap. Dans toute expérience humaine douloureuse, il y a un « détricotage » nécessaire à faire entre le bon et le mauvais qui ont été vécus. On peut avoir été battue par un homme violent, mais avec qui l’on aura eu trois merveilleux enfants. Il est cruel, ce tri à faire en soi, mais nécessaire. Il faut accepter de se confronter à ce que l’on vit et en tirer des leçons.
- Tout le livre s’articule sur la douleur de l’absence de la mère. Peut-on se remettre de cet inconsolable ?
Cet aspect du livre est fidèle à mon histoire, ça s’est vraiment passé comme ça. La Meilleure Façon de marcher est celle du flamant rose est une réponse à ce que l’on dit impossible. Faire connaissance avec sa mère mourante, trente ans après s’être vues la dernière fois, cela semble trop tard, impossible. Pourtant, le lien peut se créer, ce n’est jamais trop tard. L’important c’est d’avoir eu quelqu’un à appeler maman. On nous explique tellement que certaines choses sont impossibles, on nous met tellement de barrières : le constat d’impossibilité est une condamnation ontologique. Et je ne suis pas d’accord avec ça.
- Le processus qui vous a amenée à devenir écrivain est quasiment absent du livre, c’est étonnant, non ?
(rires) Je sais. Mais peut-être que cela vient d’une chose qui me dérange un peu. Je trouve qu’aujourd’hui, dans les romans actuels, les auteurs ont une propension à se mettre en scène en tant qu’auteur. Je n’arriverais pas à le faire. J’aurais trop l’impression de faire le sachant qui s’écrit sachant, un effet de miroir un peu vantard. C’est peut être de la pudeur, tout simplement. Et puis vous savez, écrire est un artisanat, ça se fait plus que ça ne se décrit.
- Quand on vous demande votre métier, que répondez-vous ?
Je dis auteur.
- Pas écrivain ?
Non, peut être aussi que je ne me sens pas encore forcément légitime dans ce monde-là.
- Vous vous êtes mise non à plumes mais à poil dans ce livre. Pourquoi avoir tout raconté de ce qui a tellement été douloureux ?
Il y a plusieurs raisons à cela. J’avais la sensation que c’était la chose la plus vraie et nécessaire que j’avais à donner. Mon livre, Femmes de dictateur, a été un succès mondial, mais on y trouve, comme dans les suivants, la question de la violence et même du bénéfice secondaire à la violence, du camp intérieur, de l’enfermement. La victime ébauchée de livre en livre, c’était moi. L’héroïne miss catastrophe du Flamant rose, ce François Perrin au féminin est le lien entre ce que je suis et les lectrices, qui se sont évadées ou retrouvées dans mes précédents livres. Elle permet de traverser ce qui se passe d’horrible sans culpabiliser ou alourdir la situation. Sans doute parce que je sais, quand j’écris, qu’elle va s’en sortir, malgré tout, et quel qu’en aura été le prix. C’est ma vie : j’ai mis trente ans à prendre mon envol alors que j’étais au sol et que tout semblait m’y condamner. Je me suis sentie le devoir de transmettre cette énergie.
- Comment vos lecteurs ont-ils réagi à la lecture de ce roman si vrai ?
C‘est la première fois que je reçois autant de messages positifs. Beaucoup de lectrices se prennent en photo avec le livre sur instagram, je reçois énormément de messages beaux et intimes, des gens qui me disent que je suis comme une sœur. J’ai beaucoup pleuré en l’écrivant, mais je me suis sentie bien aussi. Je ne sais pas comment vous dire cela, mais tout s’imbrique bien, tout fait sens, depuis l’écriture jusqu’à la réception du livre.
- Est-ce que ça soigne ?
Au contraire, c’est parce que c’est soigné que j’ai réussi à donner cette énergie. Cela n’aurait pas pu être un livre thérapie, il fallait que j’aie pu prendre mon envol pour l’écrire. Mon cadeau c’est ce que les gens me disent. Il y a vraiment un avant et un après ce livre : j’ai accepté d’être juste moi et j’attire des gens qui aiment ce que je suis, moi.
Chronique du roman à lire ici : Les guerres drôles et tragiques de Diane Ducret