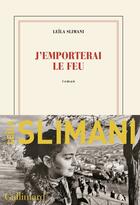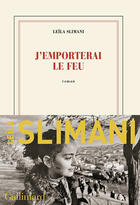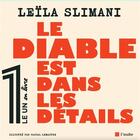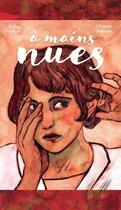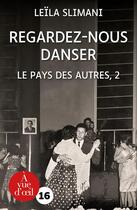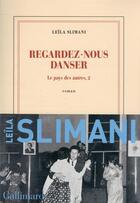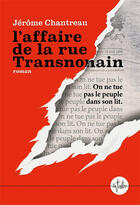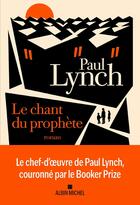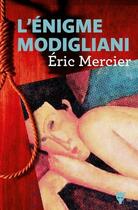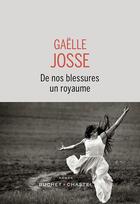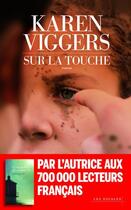Esquisser une évocation de l’histoire d’un pays, le Maroc, à travers les membres d’une famille est un exercice littéraire périlleux et semé d’embûches. Il y a danger de simplifier les choses à l’excès, d’être réducteur, partisan, Il faut aussi éviter l’éloge inconditionnel, la célébration des...
Voir plus
Esquisser une évocation de l’histoire d’un pays, le Maroc, à travers les membres d’une famille est un exercice littéraire périlleux et semé d’embûches. Il y a danger de simplifier les choses à l’excès, d’être réducteur, partisan, Il faut aussi éviter l’éloge inconditionnel, la célébration des racines incontournables sans lesquelles un être humain ne peut trouver son équilibre, ni se situer dans la nature et l’intensité de ses appartenances communautaires, religieuses, nationales.
Leïla Slimani publie le troisième tome de sa trilogie romanesque intitulée : « Le pays des autres ». Après avoir décrit dans les deux premiers tomes : Le pays des autres et Regardez-nous danser les premières générations de la famille Belhaj, entre la Seconde Guerre mondiale et les années soixante, Leïla Slimani poursuit cette évocation du Maroc des années 90 jusqu’à nos jours. L’auteure se focalise sur la troisième génération, particulièrement Inès et Mia, et sur les parcours de Mathilde, leur grand-mère née en Alsace et ayant épousée un Marocain, Amine Belhaj.
Dans les tentatives d’émancipation recherchées pas ces femmes, il y a la volonté de surmonter la peur, l’affirmation de nouveaux comportements, la recherche d’un pays où vivre sans chuchoter dans les lieux publics ou les réunions de famille. Leila Slimani rappelle que ces attitudes , ces défis aux opinions et aux conduites du moment , le conservatisme, le poids de la religion, de l’ignorance , de la bigoterie sont générateurs de danger et bien souvent de souffrance .Ainsi, Aicha Bela, gynécologue de son état, fille de Mathilde et d’Amine Belhaj, se reproche-telle un manque de détermination personnelle : « Mehdi répète que je ne m’impose pas , tu ne sais pas dire non, ni à tes filles, ni à tes patientes, ni à personne ( …) c’est la résolution que je prends maintenant que je vais avoir quarante ans, dire non, m’imposer . »
Les personnages d’une saga historique doivent exprimer leur amour de la terre natale , leur désir de voir leur œuvre perpétuée , incarnée par leurs enfants ; Mehdi Belhaj a fondé une entreprise au Maroc et il fait part de la nécessité de poursuivre son action à Selim, son fils installé aux États-Unis et y exerçant la profession de photographe, métier peu crédible pour son père : « Et je ne peux pas accepter qu’après notre mort l’exploitation reste à l’abandon (…) dans la vie, on ne fait pas ce qu’on veut et cette terre doit rester la terre des Belhaj . »
Leila Slimani évoque fréquemment les problématiques de liberté sexuelle, d’affirmation de différence. Ainsi, Mia, l’une des filles, découvre-t-elle des penchants homosexuels. Mais c’est la question de l’identité qui est évoquée, avec beaucoup de nuances et de recul. L’auteur lui accorde une place substantielle dans la vie de ses personnages, tiraillés entre la tentation de l’exil, le mal du pays, et qui ne parviennent pas à trouver une réponse univoque : « Mathilde se sentait étrangère à son enfance, comme si cette enfance n’était pas une histoire vraie mais un rêve récurrent, un souvenir incertain. Elle avait vécu au Maroc toute ; sa vie d’adulte, dans cette maison sur la colline (…) oui, ce pays était devenu le sien et elle pensa qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour vieillir. »
C’est une très belle saga romanesque que Leila Slimani nous livre. Elle se penche sur l’histoire de ce pays, en portant un regard critique, ambivalent, mais plein d’espoir. Elle évite les simplifications outrancières, les caricatures. On lira avec grand profit cette évocation du Maroc contemporain.