
Ils sont jeunes, brillants, très amoureux : les ingrédients d’une grande histoire d’amour sous le soleil d’un avenir radieux.
Vu d’un peu plus près, on remarquera toutefois que Lise est une jeune fille française issue d’une histoire vietnamienne complexe, douloureuse, dont les parents portent et transmettent malgré eux les stigmates. Louis, en revanche, fait partie de cette haute bourgeoisie parisienne souriante et confiante, qui se sait imperméable aux drames de la vie.
Leurs différences d’origine les sépareront-elles ? Possible. Comment ? C’est au lecteur de le découvrir.
On vient ici d’évoquer une histoire d’amour sous un angle social. Mais c’est un roman écrit par l’auteur de La Double vie d’Anna Song, dont on sait qu’elle ne se contentera pas du rose et noir romantique, et qui structure ses romans de manière implacable. L’histoire est une intrigue patiemment tissée, riche de références aux contes – la marque de fabrique de Minh Tran Huy – mâtinée d’une ironie parfois cruelle, et dont l’issue dénoue un double twist spectaculaire.
Dans l’interview qu’elle a donnée à Lecteurs.com, Minh Tran Huy donne les clefs pour entrer dans les coulisses de son roman qui est une lecture pour tous, certes, mais aussi une aubaine pour la critique littéraire et une bonne manne pour les ateliers d’écritures.
Karine Papillaud
Votre éditeur, Actes Sud, qualifie Les Inconsolés de « thriller romantique ». Il me semble que votre texte se situe davantage dans la filiation du roman britannique, dans le parfum des œuvres de Jane Austen ou Mary Shelley, mais se rapprochant plus précisément, dans sa capacité à nouer plusieurs motifs complexes, de l’univers de Charlotte Brontë. Qu’en pensez-vous ?
J’ai lu Jane Austen et les sœurs Brontë, mais je n’ai pas spécialement pensé à elles en écrivant Les Inconsolés. On peut toutefois s’amuser à trouver des parentés – il y en a toujours... Comme Jane Eyre ou Les Hauts de Hurlevent, ainsi, Les Inconsolés conte une histoire d’amour, de fantômes et de vengeance, avec en toile de fond un domaine à la fois enchanté et maudit, et pose la question de savoir si la passion amoureuse peut transcender les différences d’éducation et de classes sociales.
Le roman s’essaie à une analyse sociologique non dénuée d’ironie, et l’on pourrait par là le rattacher à Jane Austen. Cette dernière aime user d’erreurs de perception et de malentendus qui égarent aussi bien les personnages que les lecteurs – je pense ici à Orgueil et préjugés ou encore Emma – et j’ai voulu de faire de même, m’amuser de fausses pistes.
Enfin, mon héroïne, Lise, hésite entre un amour-passion à la Marianne, et un autre plus apaisé, à la Elinor… Marianne et Elinor qui sont les deux sœurs de Raison et sentiments, de même que Lise et sa sœur forment un duo clef dans Les Inconsolés.
Ce roman était-il celui que vous aviez en tête ? Quelle distance existe-t-il entre l’idée d’un roman au moment de sa gestation, et le texte littéraire auquel on met un point final ?
Je répondrai en évoquant la phrase de Jules Renard que j’ai mise en exergue des Inconsolés : « J’ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m’en suffiraient. » J’y ai vu une métaphore des rêves en général et de l’art en particulier. On rêve d’un chef d’œuvre – car sinon, à quoi bon ajouter un livre à tous ceux qui existent déjà ? – mais sitôt qu’on s’efforce de lui donner forme sur le papier, ne subsistent que les ruines de la merveille qu’on avait en tête.
On persiste pourtant – comme les enfants continueront toujours de bâtir des châteaux de sable que la marée emportera. On élève une pierre après l’autre son ouvrage, des fondations jusqu’à la galerie des glaces. Travaille les motifs, les symétries, les échos qui apporteront élégance et cohérence à l’ensemble. Et parfois, en effet, les ruines nous suffisent.
Quelle filiation trouvez-vous entre vos précédents livres et celui-ci ?
Mes romans, qui peuvent parfaitement se lire indépendamment, renvoient aussi les uns aux autres - à la manière de cette galerie des glaces que j'évoquais, ou d’une chambre d’échos. Je fais partie de ce qu’on pourrait appeler les écrivains sériels, qui reprennent volontiers des thèmes, des motifs, voire des personnages. Les grand-mères de La Princesse et le pêcheur et de La Double vie d’Anna Song sont très proches de celle des Inconsolés. C’est une façon de rendre hommage à ma propre grand-mère, de faire en sorte que les morts continuent à vivre…
De manière générale, j’aime jouer avec des vestiges de la mémoire familiale, dont j’intègre des morceaux ici et là, avec des variantes, comblant les blancs par la fiction : les assassinats de mon grand-père et de mon arrière-grand-père paternels, dont on n’a jamais retrouvé les corps, figurent d’une façon ou d’une autre dans tous mes livres. L’ombre de la mythique plantation, très Autant en emporte le vent, de mon grand-père maternel, qui fut forcé d’incendier la sublime maison qu’il avait bâtie alors qu’elle était le symbole de sa réussite, plane elle aussi sur La Princesse et le pêcheur, La Double vie d’Anna Song et Les Inconsolés.
Cela peut aller plus loin : ainsi l’histoire de La Princesse et le pêcheur figure en miniature – l’espace de trois paragraphes – dans Les Inconsolés. Et bien sûr l’amour prend divers visages d’un livre à l’autre : amitié amoureuse platonique dans La Princesse et le pêcheur, amour fou, désespéré – et finalement tout aussi platonique – dans La Double vie d’Anna Song, passion sensuelle et destructrice, à l’image d’un enchantement qui virerait à la malédiction, dans Les Inconsolés.
Le conte est pour vous un vecteur romanesque. Dans Les Inconsolés, on trouve des clins d’œil à toute la culture du conte occidental. Comment le conte s’est il imposé dans votre écriture et que vous permet-il ?
Quand j’avais dix-huit ans, j’ai écrit une nouvelle inspirée de ma rencontre avec un garçon de quinze ans qui avait les mêmes origines que moi, si ce n’est que j’étais née en France, tandis qu’il était un boat people. Ses parents étaient restés au Vietnam et il vivait dans des conditions beaucoup plus dures que les miennes. Nous nous étions perdus de vue et n’avions plus aucun moyen de nous contacter. Quand j’ai achevé ce texte, je me suis aperçue que cette histoire rappelait étrangement un conte vietnamien traditionnel. J’ai décidé de les entrelacer… La nouvelle a grossi, d’autres contes ont suivi les premiers, et c’est ainsi qu’est né La Princesse et le pêcheur.
J’ai toujours adoré les contes, leur imaginaire et leur magie. Ils me permettent de teinter de mystère et de merveilleux des récits contemporains. Et de laisser entendre que tout était déjà écrit, peut-être, et que l’on ne fait jamais que revivre, encore et encore, la même histoire, sous des formes multiples... Ce sont autant de mises en abyme de ce qui arrive à mes héros, et une façon pour moi de dire que toutes les histoires se rejoignent, qu’elles sont autant d’affluents du même fleuve – celui de la fiction, dont le conte est l’expression la plus pure et la plus ancienne. Ou comment, par des mots, l’on peut donner vie à des sentiments, des conflits, des espoirs, qui renvoient aux nôtres et les éclairent ; donner vie, aussi, à des êtres auxquels on croit avec la même foi que les enfants croient dans les légendes qu’on leur distille à l’oreille, le soir, avant de s’endormir.
Dans les Inconsolés, vous faites un sort au mythe du prince charmant dans lequel les films Disney et les contes d’Andersen font baigner les petites filles depuis l’enfance. Quelle part prend la désillusion, le « désenchantement » dans le premier chagrin d’amour, et quelle part celui-ci prend-il dans la construction d’un homme ou d’une femme, selon vous ?
J’ai pris un grand plaisir à jouer avec les archétypes du conte de fées : le vilain petit canard devenu cygne, la mère marâtre et la grand-mère fée, la méchante sœur, le Prince Charmant… J’ai adoré les détourner et les retourner, les personnages les plus romantiques ou les plus maléfiques n’étant pas toujours ceux qu’on croit.
Les Inconsolés traite moins, peut-être, de l’illusion et de la désillusion amoureuses que d’une désillusion qui n’empêche pourtant pas d’aimer, mais d’aimer mal, et malgré soi. Lise se rend très vite compte qu’elle et Louis ne sont pas faits l’un pour l’autre. Qu’ils appartiennent à des cultures mais aussi des classes différentes, qu’ils ont des valeurs et des principes opposés, ne serait-ce que dans leur rapport à la beauté, qui donne sens à l’existence pour elle, quand l’art n’est jamais qu’un signe extérieur de richesse ou un symbole de puissance pour Louis… Seulement c’est leur premier amour, et sa soif de se donner est telle – Lise veut aimer intensément, passionnément, absolument, à la manière d’une sainte mystique – qu’elle passe outre.
Elle décide de posséder et perdre, plutôt que renoncer – ce qu’elle aurait fait, peut-être, si elle avait été plus expérimentée. Il m’arrive parfois de dire que c’est l’histoire d’une Bovary qui aurait lu Flaubert : elle a peu vécu et beaucoup lu, et parce qu’elle a beaucoup lu, elle est consciente d’être une Bovary, et se pense lucide. Elle croit savoir ce qui l'attend. Et c’est précisément ce qui la perdra…
Votre roman traite d’un sujet plus que jamais actuel, la fracture entre l’élite et le reste de la population. Votre héroïne, Lise, est une transfuge de classe qui ajoute la question des origines à sa condition sociale. Les études sont-elles encore un vecteur d’assimilation sociale ou l’élite se borne-t-elle à une reproduction très IIIe république ?
J’ai lu Annie Ernaux et Didier Eribon avec intérêt, ils m’ont beaucoup donné à réfléchir, et je pense que Les Inconsolés s’en fait l’écho. Il y a une citation de Perec qui « donne le la » pour à peu près tous mes livres : « Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même ; quelque part, je suis « différent », mais non pas différent des autres, différent des « miens » : je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent, je ne partage aucun des souvenirs qu’ils purent avoir, quelque chose qui était à eux, qui faisait qu’ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m’a pas été transmis. »
Un palier supplémentaire est franchi dans Les Inconsolés, où Lise est étrangère non seulement à la langue, la culture, la mémoire et l’histoire de ses parents, mais aussi à leur classe. Ils sont issus de la paysannerie pauvre ; elle va grâce à ses études et à l’apprentissage de codes qu’eux n’ont jamais possédé, intégrer un établissement où l’on peut rencontrer des jeunes gens de la haute bourgeoisie comme Louis.
C’est ici la question de la méritocratie républicaine qui se pose… Elle s’apparente à mes yeux à une fiction car elle postule que tout le monde part à égalité, avec le même bagage, le même capital culturel et social, dirait Bourdieu, ce qui est évidemment faux. Bernard Lahire a montré dans ses derniers travaux que les inégalités pointent le nez dès la maternelle… Or même à supposer qu’on surmonte un peu miraculeusement ces inégalités de départ, qu’on devienne un très bon élève et que cela vous permette de changer de classe – cela a été le cas pour mes parents et dans une moindre mesure pour moi – les études ne sont un vecteur d’assimilation sociale que jusqu’à un certain point.
Si vous voulez vraiment réussir, il faut aussi vous couler dans le moule, apprendre à parler, agir et penser exactement comme les autres membres de cette classe qui ne s’interrogent jamais, eux, sur leur légitimité à être là, qui ne se sentent jamais déplacés, qui se conduisent comme s’ils possédaient le monde sans doute parce qu’ils le possèdent effectivement, comme dirait Fitzgerald. Il vous faut vous plier à leurs usages, à leurs façons d’être et de penser – car contrairement à eux, vous ne disposerez pas de filet de secours si les choses se passent mal. Vous aurez par définition besoin d’eux si vous voulez rester parmi eux.
Une intelligence exceptionnelle, de même qu’une beauté exceptionnelle ou des capacités sportives exceptionnelles, peuvent vous offrir un passe-droit, mais dans l’absolu, aucune élite, aucune classe dominante, n’a intérêt à ce que cela soit autre chose qu’une exception. Si elles veulent perdurer, elles useront de la « méritocratie » comme d’une fiction politiquement commode – je pense ici aux propos de la philosophe Chantal Jaquet. « Si on veut, on peut » est une formule séduisante, mais elle revient à dire que si l’on est pauvre, SDF, en échec professionnel ou personnel, ce n’est jamais que de votre faute. Et que si l’on a réussi, c’est parce qu’on a eu l’intelligence, l’audace et la volonté nécessaires…
C’est une vision impitoyablement individualiste et éminemment capitaliste des choses ; une manière très pratique de conforter l’ordre établi comme de se dédouaner de toute responsabilité collective.
Revivez la rencontre littéraire avec Minh Tran Huy pour Les Inconsolés
chez notre partenaire Un endroit où aller
















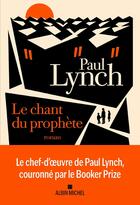


J'ai lu le livre et l'entretien m'intéresse d'autant plus!
Différence de statue ,de vie ,de milieu difficile de s adapter ,beaucoup d effort de l un est de l autre mais peut etre pour une histoire d amour heureuse un livre captivant
Je l'ai lu et je vous renvoie à mon avis! merci à lecteurs.com.
Merci beaucoup pour cette rencontre littéraire très riche . Ce roman me comble d'envie et je le note. Merci Lecteurs.com
Bonjour et merci pour cette belle chronique très intéressante.