
Entretien avec Christine Montalbetti au sujet de Trouville Casino, son nouveau roman paru aux éditions P.O.L, dont vous pouvez retrouver la chronique ici.
- Vous vous êtes inspirée d’un fait-divers minuscule, le braquage raté d’un casino par un vieil homme à l’été 2011 pour raconter votre nouveau roman. Comment l’anecdote vous est elle parvenue et pourquoi avoir écrit le roman en 2017 ?
Au moment où ce fait-divers a eu lieu, j’étais rentrée depuis quelques mois du Japon, où je m’étais trouvée à Kyoto pendant le tsunami qui avait frappé la région de Sendaï. J’avais un peu de mal à écrire après cette catastrophe de mars 2011. Je me sentais surtout habitée par le Japon. Quand je me suis remise à écrire, ce qui s’est imposé, ça a été Love Hotel, qui se passe le jour du tsunami. Ce n’est qu’après que j’ai eu le désir d’écrire Trouville Casino.
J’avais été touchée par ce fait-divers. Et d’autant plus peut-être que je suis attachée à Trouville, et que les paysages normands sont des paysages que je connais bien. J’ai commencé à prendre des notes, je suis revenue visiter le casino, mais je travaillais parallèlement à un autre roman, Plus rien que les vagues et le vent, né de ma confrontation avec les paysages volcaniques et océaniques de l’Oregon. Ensuite j’ai vraiment mis en œuvre le chantier d’écriture de Trouville Casino, et je pensais le terminer avant de commencer mon roman spatial, mais j’ai rencontré les astronautes plus vite que prévu et dans l’énergie de ces rencontres je me suis lancée dans l’écriture de La Vie est faite de ces toutes petites choses. Puis je suis revenue à Trouville Casino.
L’écriture de ce roman s’est donc développée sur une longue période, et ce qui m’a troublée, c’est la vitesse avec laquelle les décors changent. Du coup, le roman parle aussi de ça. Des transformations du casino ou des cures marines, et de la manière dont les traces de nos histoires s’effacent. Celles de cet homme, d’abord; et puis celles de ma propre histoire, avec la disparition, cet été, alors que je relisais mon manuscrit pour le rendre, d’un élément du casino dont je me suis rendu compte qu’il jouait un rôle dans ma vie.
- Comment avez-vous réussi à faire une histoire à partir de cette anecdote, sachant que vous ne saviez rien de l’homme, et que vous restez au plus près de ses actes relatés, c’est à dire en extrapolant le moins possible ?
En lisant les articles de journaux et les différents témoignages, on peut reconstituer la chronologie de ce braquage et des différentes étapes de la course-poursuite, qui constituent de vraies péripéties (barrages franchis, prise d’otage, etc). Je disposais donc d’un fil narratif, qui me permettait de mettre en place un suspense. Il y a donc cette ligne principale, celle de l’histoire cette journée de braquage. S’y tressent des évocations des paysages, et l’imagination de la vie dans ces paysages.
Dans le roman, je fais toujours une distinction scrupuleuse entre les faits avérés et ce que je m’imagine: le lecteur sait toujours s’il est en train de lire un épisode réel ou une supposition, une rêverie.
- L’écriture de chacun de vos romans semble être l’occasion pour vous d’inventer une forme, avec le motif récurrent de l’aparté comme fil rouge. Quelle serait celle de Trouville Casino ?
Ici il me semble que la forme est plus évidemment cinématographique. Mon écriture flirte depuis longtemps avec le cinéma, dans Western évidemment, ou parce qu’elle fait volontiers allusion ponctuellement à tel ou tel effet de cinéma, ou encore à cause de sa dimension visuelle; mais ici c’est vraiment la structure qui devient cinématographique. Le roman procède par séquences courtes, dans lesquelles j’indique la date, souvent l’heure, et le lieu, un peu comme dans un scénario. Le récit relève vraiment du rythme du montage, avec les séquences du braquage et de la course-poursuite, et les flash-back qui s’y insèrent.
- La narratrice du livre affleure dans le livre, à distance de tutoiement de son héros, et vouvoyant son lecteur. Quelle place, quelle intensité avez-vous souhaité lui donner ?
On est toujours un peu trois, dans un roman, le personnage principal, le lecteur et moi. De roman en roman je m’adresse à mon lecteur, parce qu’il me semble évident que mon roman est tendu vers lui. Parler à mon lecteur est pour moi quelque chose de dynamique, et je l’emmène dans ma phrase. Ici, je m’adresse aussi à mon personnage. Cette nécessité de le tutoyer est venue assez vite. Ce personnage m’émeut, et je tisse avec lui une relation particulière. Au début, il m’intéresse à cause de son étrangeté, et puis plus le récit avance, plus je me sens proche de lui, et le lecteur aussi, je pense. Ce roman s’écrit donc dans une double adresse, avec un « tu » qui désigne le personnage, et un « vous » qui désigne le lecteur. Il y a quelque chose de fluide, je crois, dans cette double adresse. Et puis il y a aussi un « je », pour que cette relation existe.
Je suis souvent présente comme narratrice dans mes romans, je peux glisser une anecdote personnelle, évoquer ma table de travail, etc. Dans Trouville Casino, je suis sans doute plus présente dans la mesure où j’évoque des souvenirs d’enfance liés à la Normandie ou mes petits voyages sur les décors de cette histoire. Je crois qu’il y a aussi comme une honnêteté à le faire, la recherche d’une position juste. Je ne peux pas surplomber cette histoire. Je raconte comment j’avance, comment j’engrange des informations, comment j’imagine parfois, et ce que je ressens aussi vis-à-vis de ce personnage, et la sorte de prudence dont je dois bien faire preuve, la timidité qui me prend à l’idée de me retrouver dans la petite ville dans laquelle il habitait, la façon dont se tisse cette relation étrange avec lui dans ce seul lieu de l’écriture (et comme pour vous dans celui de la lecture).
- Ecrire à partir de son imagination ou écrire à partir du réel, le processus d’écriture est-il le même ? Quel traitement faites-vous des personnages selon l’un ou l’autre des processus ?
Je crois que le processus est assez différent, même s’il y a des parts communes. Dans la fiction, il y a quelque chose de presque grisant à inventer des personnages et des histoires, une grande dépense d’énergie, et une sorte particulière de joie, aussi, parce que ces personnages et ces histoires naissent de la phrase même: ils n’existaient pas, et le récit les fait advenir. La phrase a cette puissance là de créer des êtres et des histoires, de faire exister des créatures en plus (même si ce sont des sortes de fantômes), des histoires en plus. Il y a là quelque chose, oui, qui est de l’ordre de la jubilation, d’une joie presque enfantine devant cette possibilité-là de créer des êtres et des situations. Mais il y a aussi quelque chose de touchant à se reposer sur une histoire réelle.
Cela nécessite également de repenser chaque fois ses moyens d’écriture, de trouver les moyens les plus adaptés au réel particulier dont il s’agit. Dans L’Origine de l’homme, mon personnage était réel, mais il avait vécu au dix-neuvième siècle, et je me sentais très libre d’inventer, même si je m’étais aussi documentée, même si j’avais lu ses écrits, même si je m’étais rendue en Picardie où il avait habité. Dans La Vie est faite de ces toutes petites choses, qui porte sur le dernier vol de navette spatiale américaine (qui a aussi eu lieu en 2011, en juillet), au contraire, très vite il m’a paru nécessaire de me fixer cette contrainte que tout serait exact jusqu’au moindre détail, pour rendre compte du nombre étourdissant d’informations visuelles disponibles sur le net. Dans Trouville Casino, je fais la part entre les données factuelles et la rêverie.
- Le passage à l’acte est l’un des enjeux du roman. Il semble que ce soit la vraie question qui vous mette à l’œuvre. Pourquoi ce moment de bascule vous fascine-t-il ?
C’est assez troublant, cette manière dont un homme, à la retraite, sans aucun passé judiciaire, décide un jour d’aller braquer un casino. Ce geste a quelque chose de singulier, d’un peu romanesque aussi, ou d’un peu cinématographique, comme s’il avait voulu devenir un personnage. Et à la fois, au fur et à mesure de l’écriture, une forme de proximité se construisait, si bien qu’il me semblait à un certain stade du récit qu’on pouvait dire qu’en un sens on était tous des papys de la côte normande…
C’est ça aussi qui m’intéressait, la tension entre cette étrangeté absolue et cette familiarité croissante. Mais je ne donne pas de solution à son geste. Ce ne serait pas ma place. Et les raisons en sont si complexes qu’il ne les connaissait peut-être pas lui-même… En tout cas j’en préserve le mystère. Je m’intéresse au suspense, au braquage et à la course poursuite, et entre ces séquences je raconte ce que j’imagine de sa vie dans la maison, de l’effet des paysages, de son rapport au temps qui passe… J’essaye de me mettre à l’écoute et je lui prête ma mélancolie…
- Il y a un insecte dans chacun de vos romans, ici c’est le perce-oreille. D’abord, qu’est-ce qui est à l’origine d’un tel petit rituel, et ensuite pourquoi un perce-oreille ?
Pourquoi ce rituel? Je crois que de façon générale j’aime prêter des sentiments forts aux insectes (ou même parfois aux objets) parce que cela me permet de traiter de sentiments douloureux d’une manière humoristique. Dans Journée américaine par exemple il y a tout un chapitre qui raconte un match de football depuis le point de vue des moustiques (et qui parle aussi bien de leur liesse du début que de leur sentiment croissant de dégoût devant cet énorme buffet à volonté de l’assemblée des spectateurs, ou encore de l’abandon des larves à leur naissance…). Ici, le perce-oreille qui traverse le salon a peur d’être écrasé. C’est une façon de parler de la peur de la mort, mais à une échelle d’insecte, avec une tonalité plus douce et presque ludique.
Je ne m’étais pas posé la question, mais je crois que j’ai choisi un perce-oreille parce que dans mon enfance ces insectes-là m’intriguaient, avec leurs crochets bizarres, et que je pouvais passer beaucoup de temps à les regarder dans la maison normande dans laquelle je passais mes vacances. C’est donc un insecte qui est lié pour moi à la Normandie, dans laquelle se passe cette histoire; et à l’enfance, aussi, à laquelle par ailleurs je repense dans le roman, parce que c’étaient les années Mesrine, et que je me souviens de la peur que j’en avais petite fille.
- J’ai remarqué une adresse aux blogueurs (p. 179) qui porte sur la critique facile dont ils peuvent être les auteurs. Quelles limites trouvez-vous au blogging littéraire ?
Je trouve formidable cette énergie de lecteurs et de lectrices, et ce désir de communiquer autour de ses lectures. Mais parfois je suis un peu déstabilisée aussi par la position de surplomb, et par le fait que les critères qui sont convoqués sont quelquefois extérieurs aux textes. Chaque auteur invente son esthétique, un texte littéraire est d’abord un texte qui surprend, et donc sa lecture, autant que possible, repose sur une écoute de sa singularité. Sur cette question de la digression en particulier (sur laquelle porte cette adresse), je me dis que l’école n’a pas fait que du bien, en affirmant que dans les copies il fallait censurer la digression. C’est peut-être vrai d’une dissertation, mais pas d’un roman! Chaque romancier crée son propre rythme.
Il y a autant de manières d’écrire sur les livres que de blogueurs. Je crois que je suis plutôt pour les analyses critiques qui défendent les livres, qui mettent en valeur ce qui dans ces livres les intéresse : ce qu’on place dans un livre est si intime, le geste même d’écrire est si intime, que les critiques négatives sont forcément douloureuses. Pour ma part, je ne prendrais pas la plume (je n’ouvrirais pas un fichier d’ordinateur) pour émettre des réserves sur un livre. Je trouverais que c’est une violence inutile. Quand il m’arrive d’écrire sur les livres des autres, je choisis d’écrire sur les livres que j’aime (et sur ce que j’aime dans ces livres), pour tenter de mettre des mots sur leur beauté.
Retrouvez la chronique du livre ici.
Relire l'article : 2018, fossoyeuse de l’édition française ? 2018 commence abruptement avec la mort des éditeurs Bernard de Fallois et Paul Otchakovsky-Laurens, et celle du grand écrivain israélien Aharon Appelfeld".
















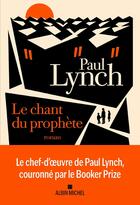


Un gros coup de coeur ce livre. Comme chaque livre de Montalbetti de toute façon !
Thème très intéressant sur le casino et son braquage un sujet que je n ai jamais eu l occasion de lire vraiment a decouvrir
C'est l'un des romans que je souhaite lire suite à cette nouvelle sortie littéraire. j'espère en avoir l'occasion.
Très très très envie de lire ce livre!!!