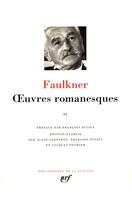Une des œuvres majeures de la littérature américaine pour laquelle je vais être dithyrambique car pour reprendre les termes de Kafka, elle aura été une hache qui a brisé la mer gelée en moi. L’écriture époustouflante est le premier intérêt à la lecture de ce texte.
L’histoire est celle de...
Voir plus
Une des œuvres majeures de la littérature américaine pour laquelle je vais être dithyrambique car pour reprendre les termes de Kafka, elle aura été une hache qui a brisé la mer gelée en moi. L’écriture époustouflante est le premier intérêt à la lecture de ce texte.
L’histoire est celle de Thomas Stupen et sa descendance.
Le sujet : la paternité, l’héritage et sa violence, de l’intimité à l’universalité.
Le titre : Absalon ! Absalon ! : Cri du roi David pleurant son fils. Une tragédie.
Dès les premiers mots, on sait avoir entre les mains un texte écrit par un immense écrivain.
A l’image de la couverture, on va entrer dans un texte labyrinthique, vu au travers d’un caléidoscope, aux phrases d’une longueur proustienne (ou Enardienne), qui vous embarque sur une clarté tonitruante et va vous trainer jusqu’à l’obscurité d’un chuchotement pour vous ramener d’une facette à l’autre comme il écrit alors :
« Et ce qu’elle vit alors ne fut que ce visage d’ogre aperçu jadis dans son enfance puis réapparu à des intervalles et à des occasions qu’elle ne pouvait ni se rappeler ni dénombrer, comme le masque de la tragédie grecque, interchangeable, non seulement d’une scène à l’autre mais d’un acteur à l’autre et derrière lequel se jouent sans ordre logique ou chronologique événements et péripéties, la laissant littéralement incapable de dire combien de fois distinctes elle l’avait vu pour la raison que, éveillée ou endormie, la tante lui avait appris à ne pas voir autre chose. »
Faulkner ne quitte pas un instant son lecteur. Il va le pétrir, le malaxer, le caresser, le brutaliser, le détester et l’aimer. Le secouer. L'engluer au texte. L’obliger à être présent, là où il est dans son éthylisme, sa folie et son réalisme. Il veut que son lecteur l’écoute et ouvre les yeux, comprenne où il en est, ce qu’il veut dire de cette société américaine avant, pendant et après la guerre de Sécession, qu’il ait son avis sur l’esclavage des noirs, les peurs et dérisions dans le grand écart Nord/Sud, le racisme entre nous, entre blancs, entre classes sociétales des nantis et des oubliés, des enfants abandonnés et voire reniés, des relations incestueuses et tueuses, des justices et injustices de ce bas monde, des origines incertaines de chacun d’entre nous, de l’impuissance et la puissance au sein du pouvoir, de l’arrivisme et des portes fermées des soi-disant bien-nés, bien-éduqués, des riches, des intellectuels et ce cloisonnement infranchissable… entre nous malgré tous les efforts d’un paysan, d’un esclave, d’un ouvrier, d’un petit boutiquier ou d’un guerrier qui, intrus, se rejettent les uns les autres comme des pierres sur l’eau formant des ondes frontalières, et qui pour celui qui refuse cet état de fait, va le conduire au vol, au barbarisme, à la haine, à la réclusion, l’enferment jusqu’à la folie de lui-même.
Ce livre c’est avant tout, lire de l’écriture. Bien entendu, il y a une histoire. Une histoire très tendue d’ailleurs. Celle de Thomas Stupen, sa descendance et son époque. Mais elle n’est que prétexte à des réflexions sur la société et à la passion d’écrire.
Après avoir été renvoyé par un Noir à la porte d’un aristocrate, Stupen n’a pas soif de vengeance mais veut devenir un homme du même bord.
Il ira mater les Noirs en Haïti et partira ensuite dans une petite ville avec la ferme intention d’établir sa propre dynastie.
Stupen va arriver à Jefferson, petite ville bourgeoise du Mississipi. Il arrive comme un diable sorti de sa boîte. ‘Diable’ non, mais démon.
« (…) c’était un homme dans les vingt-cinq ans, ainsi que la ville allait l’apprendre plus tard, car à cette époque-là on n’aurait pas pu deviner son âge parce qu’il avait l’air de relever de maladie. Non pas l’air d’un homme qui avait été paisiblement malade dans son lit et qui une fois rétabli se mouvait avec une sorte d’effarement maladroit et mal assuré dans un monde qu’il s’était cru sur le point de quitter, mais celui d’un homme qui avait traversé quelque solitaire et cuisante épreuve et non une simple fièvre, comme par exemple un explorateur, qui avait dû non seulement affronter la fatigue normale de la tâche qu’il avait entreprise mais aussi supporter le handicap supplémentaire et imprévu de la fièvre, et qui s’en était tiré au prix énorme, moins physique que mental, seul et sans aide et non à cause d’une aveugle et instinctive volonté de durer et de survivre, mais enfin de conquérir et de conserver pour sa satisfaction l’avantage matériel pour lequel il avait à l’origine accepté le risque. Un homme fortement charpenté mais pour le moment d’une maigreur quasi squelettique avec une courte barbe rousse qui donnait l’impression d’un déguisement et au-dessus de laquelle ses yeux pâles avaient une expression à la fois visionnaire et vigilante, impitoyable et paisible, dans un visage dont la chair ressemblait à de la faïence, avait l’air d’avoir été colorée par cette fièvre de fournaise, que celle-ci ait été intérieure ou extérieure, plus profondément que par le soleil seul, au-dessous d’une couche superficielle inerte et impénétrable comme de l’argile vernissée. »
Et plus tard,
« Il était sur le cheval rouan, avec la redingote et le chapeau de castor qu’ils lui connaissaient et les jambes enveloppées dans un morceau de prélart ; il avait sur le pommeau de la selle un portemanteau et tenait à son bras un petit panier tressé. Il arrêta le cheval rouan (on était au mois d’avril et la route était encore en fondrière) et resta là, dans son prélart maculé de boue, à les regarder l’un après l’autre ; ton grand-père m’a dit que ses yeux ressemblaient à des morceaux d’assiette cassée et que sa barbe était aussi dure qu’une étrille. »
Il (Stupen) va acheter, on ne sait comment, une des terres les plus rentables de la région à un chef indien qui s’appellera, qui sera nommée les ‘Stupen’s hundred’. Il va avoir des facilités financières avec des notables on ne sait pourquoi. Il aura une armada d’esclaves noirs soumis qui feront fructifier la plantation de canne à sucre à coups de fouet. Il ne s’agit pas de racisme car à l’époque les noirs d’Amérique étaient une denrée comme une autre et on les achetait sur des marchés aux esclaves. Au-delà de les faire travailler, Stupen organisera des combats comme on parie sur des combats de coqs et des fois, lui-même (Stupen) se prêtera au jeu sur le terrain en toute innocence, incapable de comprendre la souffrance humaine moindre à ses yeux que celle même des animaux. Il reviendra avec des charrettes chargées de meubles, d’étoffes et de richesses et on ne saura pas d’où tout cela vient... Enfin, si, ce sera expliqué après. Avec l’autre regard. Un des autres regards du kaléidoscope. Ainsi que la présence de cet architecte venu de nulle part qui lui construira sa maison quand lui,
Stupen réalise que ce qui lui manque c’est une femme, des enfants, la crédibilité d’une famille. Pas par romantisme ni amour mais au nom de l’identité de la réussite, Stupen va instrumentaliser son entourage. Et il aura la fille d’un commerçant, un commerçant qui lui cédera, sa fille, on ne sait sous quelle influence, de quelle influence Stupen a, sinon être un homme baraqué, troglodyte, violent et sauvage mais qu’on soupçonne avoir des cartes en mains, une fortune secrète à la source inavouable, des moyens de pression secrets, un jeu que personne ne connaît ni ne sait déchiffrer et reste une énigme. Il aura un fils et une fille de cette femme mais il a déjà une autre fille engendrée avec une esclave noire qui, elle, ne peut pas être héritière du domaine et restera servante.
Jusqu’au jour où son passé va rattraper Thomas Stupen…
Un fils qu’il aura eu avec une riche héritière, non reconnu et maudit, va le retrouver et consanguinité, inceste, paternité, mélange des races et des classes sociales vont cruellement s’inviter au récit en liant l’intimité à la grande Histoire collective des États-Unis, ses premiers migrants (blancs) arrivés par bateaux entiers porteurs de prisonniers libérés par les colonies anglaises, sa guerre de Sécession et sa ruée vers les grandes plantations de canne à sucre du Sud et la soif immodérée de faire fortune coûte que coûte.
Après que Faulkner nous aura, nous, le lecteur, moi, lectrice hébétée dans cette lecture, anéantie sous les mots, embarquée sur des phrases plus longues que le trajet de tous les cargos et vapeurs du monde sur mer calme et tempêtes, cul par-dessus tête dans des rouleaux de mots, frappée contre des roches d’encre noire, hachée menu, emportée en haut d’un sommet, il va me prendre la main qu’il n’aura jamais lâchée depuis le début, alors disons qu’il va s’assurer que je suis toujours là, et me faire redescendre l’autre versant à moitié livre, sur une pente un peu plus douce bien que les épines de ronces égratignent et que le terrain est bourbeux, limoneux, truffé de pièges, même si la suite se dit dans une chambre universitaire non chauffée d’Oxford, un versant qui apporte des explications par la voix de deux jeunes étudiants décryptant la saga de cette famille de fous ou cette vie qui rend dingue. Deux regards nouveaux et complémentaires qui disent, redisent et répètent l’histoire de Stupen et Stupen’s hundred.
Ces deux voix en spirale, sont celle du jeune Quentin, qui est déjà présent au tout début et son ami de chambrée universitaire. Ils vont retracer l’histoire de 1807 à 1910. Et je recopie ici ces premiers mots qui m’ont fait dire que j’avais le texte d’un grand écrivain entre les mains et m’a fait poursuivre la lecture de ces 420 pages détonantes de talent, où le personnage de Quentin Compson, né à Jefferson, extérieur à la famille Stupen, apparait déjà et sera le personnage qui soutiendra l’histoire dans sa cohérence car son grand-père était un des rares proches de Stupen et que le grand-père aura raconté une bonne part de l’histoire à son fils qui lui-même l’aura raconté à son fils, comme un symbole de la transmission d’un héritage de la mémoire. Quentin en introduction du livre, ira jusqu’au point final, car il y aura un point final à l’histoire de cette dynastie fabriquée qui tout feu tout flamme connaîtra la cendre tout comme le Sud s’effondrera en libérant le pays du lourd fardeau de l’esclavagisme laissé en héritage mémoriel lui aussi.
Rapporteur, Quentin sera aussi l’auditeur, celui qui aura écouté, entendu, vu.
Le début du livre, c’est ça :
« Depuis un peu après deux heures jusqu’au déclin du long et torride après-midi de septembre, immobile torpide et mort, ils restèrent assis dans ce que Miss Coldfield continuait d’appeler le bureau parce qu’autrefois son père l’appelait ainsi — pièce obscure torride et sans air dont les persiennes demeuraient toutes fermées et verrouillées depuis quarante-trois étés parce que du temps où elle était petite fille quelqu’un avait cru que la lumière et le déplacement de l’air véhiculaient la chaleur et que l’obscurité était toujours plus fraîche, et que traversaient (à mesure que le soleil frappait de plus en plus directement ce côté de la maison) des rais jaunes chargés de grains de poussière que Quentin prenait pour des particules de la vieille peinture morte et desséchée, détachées des persiennes écaillées comme si le vent les eût projeté à l’intérieur. » Sur un treillage de bois devant l’une des fenêtres fleurissait pour la deuxième fois de l’été une glycine où de temps en temps s’abattaient fortuitement des volées de moineaux qui l’emplissaient de leur bruissement sec et poussiéreux avant de s’envoler ; et en face de Quentin, Miss Coldfield, dans l’éternel noir qu’elle portait depuis quarante-trois ans pour sa sœur, son père ou son absence de mari, nul ne le savait, assise tellement raide sur la dure chaise au dossier droit si haute pour elle que ses jambes pendaient aussi droites et rigides que si elle avait eu des tibias et des chevilles de fer, sans toucher le plancher, avec cet air d’immobile et impuissante fureur qu’ont les pieds d’enfants, et parlant de cette voix sévère effarée étonnée jusqu’à ce qu’enfin l’écoute cessât et que la faculté d’entendre se troublât, et que l’objet depuis longtemps défunt de son impuissante et insurmontable frustration apparût, comme évoqué par la répétition scandalisée, paisible distrait et inoffensif, surgi de la patiente rêveuse et victorieuse poussière. »
La tante ne lâchera rien. Après la mort de sa sœur Ellen, l’épouse de Stupen, après que les hommes soient revenus en charpie de la guerre, vaincus par le Nord, la tante Rosa s’offrira à Stupen à son tour et Stupen à nouveau, démon rustre qui ne fera que se servir d’elle lui annonce qu’il ne l’épousera qu’à la condition d’avoir un fils et Rosa humiliée, le quittera et se réfugiera chez elle, chez son père, s’étiolera comme une feuille d’automne mais gardera en elle violence, haine et vengeance.
La tante Rosa, personnage gothique, convoque Quentin. Elle veut que quelqu’un puisse raconter toute l’histoire du début à la fin. Quentin verra le dernier héritier. Une fin ironique évaporée dans les brumes...
Cette histoire chaotique somme toute hyper tendue est rugueuse, brutale, habitée par la peur, la bestialité, où gloire et déchéance ont le goût âpre de la terre, de la boue, du limon, de l’argent et de la misère, de l’intolérance, de la trahison et des injustices, de l’égoïsme et l’avidité, et pour autant pleine d’ironie, d’amitiés et d’innocence, tout imbibée de l’Histoire du Sud des Etats-Unis d’où William Faulkner est originaire, avec une âpreté et une souffrance qui va faire résonance au plus profond de nous.
Une tragédie sombre et lumineuse. Mais surtout une plume incroyable qui n’a de cesse de mettre à nu et questionner !
La complexité de cette narration sans presque de ponctuation, a déversé en moi le flot d’une énergie forte que je ne connaissais pas et que j’ai toujours du mal à déterminer mais qui, de façon certaine, m’a ébranlée et s’est incrustée au fin fond de mon regard sur ce qu’est lire et écrire. Je me suis rarement sentie aussi fortement empoignée par un auteur.
C’est inracontable.
C’est une force.
Un séisme.
Une majesté.
Une substance littéraire qui refuse toute passivité et fuit le bavardage.
William Faulkner était un génie.