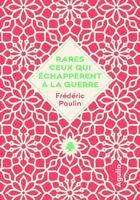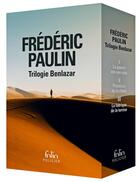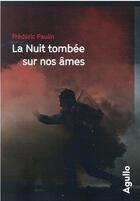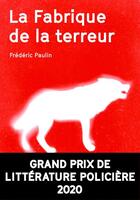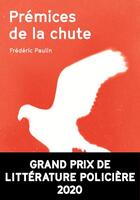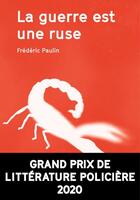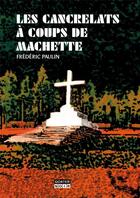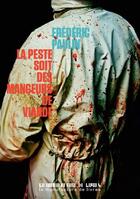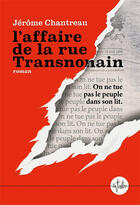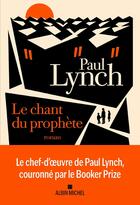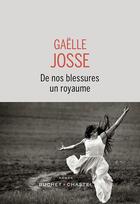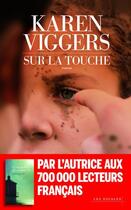Second épisode de la saga de Frédéric Paulin sur l'histoire récente du Liban. le récit est toujours aussi soigneusement documenté et toujours instructif et passionnant.
Nous voici maintenant au coeur des années Mitterrand avec la période 1983-1986.
Frédéric Paulin s'est fait une spécialité...
Voir plus
Second épisode de la saga de Frédéric Paulin sur l'histoire récente du Liban. le récit est toujours aussi soigneusement documenté et toujours instructif et passionnant.
Nous voici maintenant au coeur des années Mitterrand avec la période 1983-1986.
Frédéric Paulin s'est fait une spécialité de romans (façon thrillers) avec lesquels il éclaire la géopolitique de notre Histoire contemporaine à travers celle des pays qui nous sont proches : après la série sur l'Algérie, c'est au tour du Liban.
Prof d'histoire-géo, journaliste, il a entamé l'an passé une nouvelle série destinée à mieux nous faire comprendre les enjeux des conflits libanais. Vaste entreprise (!) dont le premier titre Nul ennemi comme un frère est paru en août dernier et couvrait la période de la guerre civile des années 70.
Le premier tome se refermait en 1983, au jour des terribles attentats qui visèrent les américains à l'aéroport de Beyrouth et les français dans l'immeuble Drakkar.
On avait laissé le Liban à feu et à sang, et on le retrouve de même dans ce second épisode, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, qui couvre une période plus courte (1983-86) au coeur des années Mitterrand.
Depuis des millénaires, le Liban est le centre géopolitique du Moyen-Orient et aujourd'hui toujours, le coeur d'une région en train d'imploser.
Sur place, Frédéric Paulin a convoqué tous les acteurs de l'époque.
« [...] D'un côté de la table, le camp chrétien : Amine et Pierre Gemayel, et Camille Chamoun. En face, les autres, tous les autres : le Front du salut national, pro-Damas, représenté par le chrétien Soleiman Frangié, le sunnite Rachid Karamé, l'ancien Premier ministre, et le druze Walid Joumblatt, les chiites Nabih Berri et Adel Osseirane, et les sunnites menés par Saëb Salam. »
Pour la trame romanesque de cette série, Frédéric Paulin a réuni, aux côtés des personnalités bien réelles de l'époque, quelques personnages de fiction que l'on retrouve avec plaisir dans cet épisode et qui vont continuer à nous servir de guides dans l'imbroglio libanais où se mêlent trop étroitement politique, guerre et religion : Philippe Kellermann l'agent de l'ambassade shooté aux anxiolytiques, Zia al-Faqîh la belle interprète chiite, l'arrogant Christian Dixneuf l'agent de la DGSE, la juge antiterroriste Gagliago et son mari des RG, les chrétiens maronites de la famille Nada, ...
Les années 83-86, ce sont les années Mitterrand on l'a dit, le début de la cohabitation avec Chirac, la série d'attentats terroristes à Paris, les otages au Liban (les Seurat, Kauffmann, et d'autres) : ce sont les années où les errements de la France au Moyen-Orient s'invitent dans la politique intérieure de notre pays.
Le contentieux avec l'Iran du prêt Eurodif n'est toujours pas soldé, la France fournit toujours des armes à l'Irak, et pour libérer les otages du Hezbollah, les négociations croisées menées à la fois par les émissaires de Mitterrand et ceux de Chirac-Pasqua jouent une farce grotesque qui ferait rire aujourd'hui si la vie des otages n'était pas en jeu (Michel Seurat décédera d'un cancer non soigné à Beyrouth) : un triste spectacle, qu'il est édifiant de revoir avec le recul nécessaire.
On refermera cet épisode dans le bruit de l'explosion de la rue de Rennes ...
➔ Les ouvrages de Frédéric Paulin sortent au même moment que le polar de David Hury que l'on vient de lire : Beyrouth Forever.
Le roman de David Hury était pétri de vécu et nous donnait une vue synthétique de l'histoire du pays. Désespérante mais synthétique.
Les bouquins de Frédéric Paulin fournissent un éclairage plus politique et une vue plus analytique de l'histoire du pays.
Désespérante mais analytique.
Il est naturellement inutile de comparer les deux oeuvres, mais il est intéressant de constater comment elles se complètent mutuellement.
➔ F. Paulin parle évidemment du Liban mais on (ré-)apprend également beaucoup de choses sur la France de l'époque, celle qui croyait encore tirer les ficelles de sa diplomatie : nous voici au coeur des années Mitterrand, dans les coulisses où se jouent les grandes manoeuvres de Tonton pour consolider son pouvoir et celles de la droite pour le reconquérir derrière Chirac et Pasqua.
Il n'est jamais inutile de réviser un peu notre propre passé récent, même avec une vue depuis Beyrouth !
➔ Bien sûr c'est un roman, avec quelques personnages de fiction (mais très peu), avec des espions et de l'action, des victimes et du suspense, des méchants et des gentils (euh, des gentils, y'en n'a pas beaucoup), mais ce n'est pas un thriller à la James Bond, c'est un roman à la belle façon de Frédéric Paulin : c'est L Histoire avec un grand "H" qui nous est contée et les faits relatés sont méticuleusement vérifiés par cet auteur scrupuleux qui possède l'art et la manière de mettre tout cela en lumière pour notre bonne compréhension. Question de perspective.